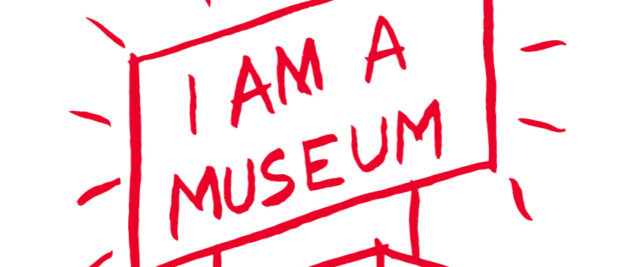Découvrez la conférence du célèbre architecte new-yorkais
Lors du colloque Musées du XXIe siècle organisé en juin 2017, les Musées d’art et d’histoire ont eu le plaisir et l’honneur de recevoir l’architecte new-yorkais Daniel Libeskind. Durant une heure, l’architecte américain est revenu sur certains de ses projets emblématiques et a évoqué les éléments majeurs qui président, selon lui, à la réalisation d’un bâtiment. Partageant avec son public certaines de ses convictions les plus profondes, Daniel Libeskind a même suggéré que visiter un musée devrait «changer notre vie!». Un échange passionnant à (re)découvrir en intégralité et sous-titré en anglais et en français.
Un lieu identitaire pour le peuple kurde
Daniel Libeskind (né en 1946, Łódź, Pologne) ouvre l’échange en évoquant un projet qui lui tient à cœur, le Kurdistan Museum. Les plans le situent au pied d’une ancienne citadelle à Erbil au nord de l’Irak. Ce futur musée – dont la construction dépendra de la stabilisation du territoire – doit être le premier consacré au peuple kurde. Il a été notamment présenté au MAH dans le cadre de l’exposition Musées du XXIe siècle. Visions, ambitions, défis. Composée de quatre corps de bâtiment, sa forme représente les États sur lesquels le territoire kurde s’étend actuellement: la Turquie, la Syrie, l’Irak et l’Iran. Deux lignes scindent l’édifice; l’une commémore le génocide des Kurdes irakiens et l’autre représente la liberté symbolisée par une flamme éternelle.

Ce geste architectural fort doit faire figure d’emblème pour le peuple kurde et créer un lieu identitaire. Libeskind place au centre de sa réflexion la notion de liberté – aussi bien physique que spirituelle. Dans sa vision, un bâtiment ne doit jamais être empreint de nostalgie, mais parler à notre époque et indiquer une direction à l’attention des générations futures.
La symbolique du geste
Tout au long de sa conférence, Daniel Libeskind affiche un enthousiasme communicatif, habité par un optimisme à toute épreuve alors même qu’il œuvre le plus souvent dans des lieux hantés par des régimes oppressifs et marqués par la guerre. Le Modern Art Museum de Vilnius en Lituanie, l’un de ses derniers projets en cours de construction, abritera par exemple une collection d’artistes locaux qui ont produit des œuvres sous l’occupation soviétique. Il s’agira là de son premier musée consacré exclusivement à l’art moderne et conçu sans structure préexistante.

Jusqu’ici, Libeskind a en effet toujours travaillé à partir d’un bâtiment historique. Le plus grand musée d’Allemagne, le Musée d’histoire militaire de Dresde (2011) en est une des plus célèbres illustrations. L’architecte explique ses choix décisifs au moment de son extension: plutôt que d’occulter l’histoire militaire allemande, il choisit de la représenter de façon subtile en fendant délicatement la façade protégée du XIXe siècle par deux lignes étroites. La forme triangulaire du bâtiment qui surgit alors évoque celle des avions alliés qui ont détruit Dresde en 1945. Ce type de geste architectural, parfaitement assumé, vise à mettre en exergue les moments marquants de l’histoire.

Oser déranger
Libeskind fait rarement dans la demi-mesure; il prône l’ambition et les prises de risques. On ne sort en effet pas indemne du Musée juif de Berlin ou de la Felix Nussbaum Haus à Osnabrück en Allemagne. Le visiteur y est guidé différemment, transporté par les émotions – centrales tout au long de sa démarche. Avec ses constructions engagées, le New-Yorkais souhaite initier un frisson qui parle aux humains et les touche au plus profond de leur être. Pour Libeskind, une visite n’est pas une expérience intellectuelle mais synesthésique, faisant appel à tous nos sens, à notre corporalité.
Selon lui, un musée ne doit surtout pas ressembler à «un pénitencier de l’esprit» («penitentiary for the mind»); au contraire, l’architecte cultive une approche non conventionnelle de l’art et vise ainsi une expérience authentique, aussi inattendue que bouleversante. Il va même jusqu’à provoquer à dessein une émotion dérangeante à l’approche de certaines œuvres. Il ne veut pas d’un lieu qui «anesthésie» le public car selon lui, «le choc d’une visite devrait changer notre vie ou le choc de la rencontre avec une œuvre d’art, sinon cela voudrait dire que nous ne sommes pas vivants ou que l’œuvre ne l’est pas!» L’objectif consiste à comprendre pourquoi l’artiste crée et pour qui. Cette rencontre avec l’œuvre est pour lui l’occasion d’une renaissance, d’une régénération. On touche au sacré.
Un architecte à l’écoute
Avant de concevoir un nouveau bâtiment, Daniel Libeskind prend le temps de s’imprégner de son environnement immédiat; il puise son inspiration dans la lumière et la géologie même du lieu, autant d’éléments qui donneront au futur édifice un ancrage organique avec l’espace dans lequel il émerge. L’Américain se documente systématiquement sur la culture du pays pour que ses constructions relatent à leur manière son histoire. Il aime à dire par exemple que les façades de ses bâtiments sont des visages expressifs faits d’acier, de pierre, de ciment, de bois et de verre.
Outre les interactions avec l’environnement, il souligne également la nécessité d’une confrontation avec les nombreuses parties prenantes engagées dans la réalisation d’un projet. Se défendant de travailler dans une tour d’ivoire, il parie même sur un «futur démocratique», bien que fragile, de l’architecture. Idéalement, chacun devrait pouvoir se prononcer sur l’évolution de son lieu de vie et même participer à sa construction.
Des vides essentiels
Cette conférence ne pouvait se conclure sans évoquer le plan directeur du World Trade Center, projet pharaonique remporté après de nombreux rebondissements par le Studio Libeskind. Aujourd’hui sur le point d’aboutir, cet ensemble n’est pas anodin pour l’architecte, qui, à l’âge de treize ans, débarquait avec sa famille dans le port de Manhattan à bord de l’un des derniers bateaux de migrants. Près de quarante ans plus tard, au moment de concevoir la Freedom Tower, pensée notamment pour imiter le geste triomphal de la liberté, il aura en mémoire sa première rencontre déterminante avec la ville de New York.

Libeskind a eu l’audace de proposer une construction située en dehors de la zone imposée et de consacrer une partie importante de cette parcelle, pourtant restreinte, au public, comme espace de mémoire et de vie. Dans un tissu urbain aussi dense que celui du Lower Manhattan, il a osé considérer ces vides comme essentiels. Les tours qu’ils dessinent, «modestes et sûres», sont élancées, aussi éloignées que possible du site pour permettre à la lumière d’y entrer et de lui conférer ainsi le «spirit» nécessaire au lieu.
«L’architecture est un acte de foi»
Musicien prodige durant ses jeunes années, Libeskind fait volontiers appel à la musique, à l’art et à la littérature. Ses bâtiments témoignent de cet ancrage culturel qui leur confère une profondeur, aussi bien réelle que symbolique. À ce titre, les fondations du World Trade Center sont révélatrices. Libeskind et sa femme Nina ont très vite été attirés par le «slurry wall», le mur d’étanchéité, rouillé et ruisselant, visible après l’effondrement des deux tours. Ils se sont empressés de descendre dans les entrailles pour sentir la symbolique forte d’un mur qui fait barrage contre les eaux de l’Hudson. Le pape François a perçu lui aussi la charge émotionnelle de ce mur en choisissant de s’y rendre pour délivrer son message œcuménique, soulignant de la sorte l’importance des fondements, de l’invisible. Bien que le site tout entier porte les stigmates de la tragédie, la Freedom Tower regarde vers l’avenir, baigné de lumière, à l’image de son créateur car «l’architecture, au bout du compte, est un acte de foi».