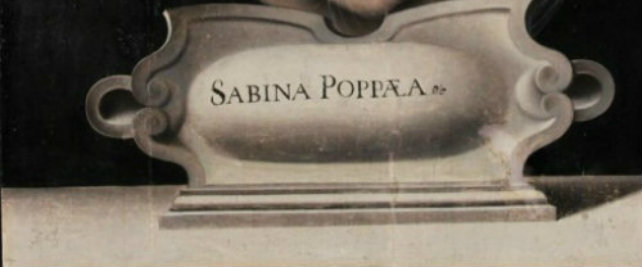Faisant suite au travail de restauration de la Sabina Poppæa, le Musée d’art et d’histoire a organisé, le 28 février dernier, une journée d’étude pour réunir des chercheurs de divers horizons. Le choix du titre, Sabina Poppaea dévoilée, n’était pas anodin, puisqu’il fait référence au mystère qui enveloppe ce tableau clé de l’École de Fontainebleau et fait allusion à ce fameux voile qui habille Sabina Poppæa sans vraiment la couvrir. Les contributions ont ainsi joué sur le double sens des mots, mais aussi sur d’autres dualités qui sont apparues au fil des interventions: cacher/montrer, femme pudique/courtisane, personnage historique/archétype iconographique, etc.
Mais revenons au titre. Nous affirmions: Sabina va être dévoilée. Or l’a-t-elle vraiment été? Approchons-nous plus près de ce que nous avons entendu des experts et tentons de ne pas répondre trop hâtivement…
D’œuvre mineure à œuvre majeure
Lors de son entrée au Musée d’art et d’histoire en 1839, la Sabina Poppæa a été considérée comme une œuvre mineure appartenant à l’école vénitienne ou à l’«École de Titien». Aujourd’hui, elle fait partie des œuvres majeures de la collection. Ce portrait anonyme est devenu une œuvre emblématique de l’École de Fontainebleau, grâce à l’intérêt grandissant des collectionneurs, chercheurs et amateurs français et suisses pour la peinture française du XVIe siècle.

Pourtant, nous ignorons presque tout de ce tableau: faisait-il partie d’une collection italienne, comme pourrait le laisser supposer un chiffre découvert lors de la restauration? Les données sont trop lacunaires pour l’affirmer… A-t-il été réalisé par le cercle de François Clouet, peintre officiel de François Ier et d’Henri II et célèbre pour ses tableaux de dames au bain? Même si l’inspiration est voisine, le style reste différent.
Si les informations que nous possédons sur ce portrait sont limitées, ceci n’empêche pas de tisser des liens et de trouver des repères. Les références à l’Antiquité sont évidentes, même si la typologie est plus proche des modèles italiens et nordiques du XVIe siècle (de Léonard de Vinci avec cette figure qui pivote et ce geste de la main, mais aussi de Lucas Cranach avec le graphisme du drapé et le fond noir).
Le travail de restauration et l’étude de la technique picturale menés par l’atelier de restauration du MAH appuient également cette double influence (italienne et nordique). Il a aussi dévoilé des éléments techniques apportant un nouvel éclairage. Le modelé du visage est très précis, tandis que les parties du corps couvertes par le voile sont plus libres. Ces dernières sont à peine esquissées, très différentes du sfumato et de la pose très minutieuse de la couleur du visage. Le travail de restauration nous donne aussi des réponses précises à des questions anciennes: le fond a ainsi toujours été noir, le tableau n’a jamais été coupé ni les dimensions altérées. Mais le support du tableau ayant été transformé, la perte d’information occasionnée ne permet pas de dater l’œuvre de manière précise.
La figure de Sabina Poppæa et sa réception dans les arts
Plus nous approchons la figure de Sabina Poppæa, plus elle nous échappe. Car même si elle a été l’objet de représentations postérieures, même si sa vie et ses mœurs ont fait l’objet de descriptions, son image reste diffuse. Nous avons une connaissance limitée de la représentation de ce personnage dans la statuaire antique (aucun portrait n’a été clairement identifié). Dans les textes, le caractère de Sabina a été souvent décrit comme vaniteux et ambitieux; des traits négatifs qui servent souvent aux auteurs comme contre-exemple à des causes plus politiques et morales (l’éloge de la simplicité, de la vertu, etc.).
La figure de Poppæa qui nous est ainsi parvenue relève de reconstructions, d’interprétations, d’idéalisations… Autant, alors, sauter le pas et voir dans le tableau du MAH, non pas un portrait de Sabina Poppæa, mais un archétype qui renvoie à des figures et des motifs très en vogue à la Renaissance. Nous ne serions pas devant une Poppæa historique, mais devant une représentation qui fait écho à d’autres figures féminines, contemporaines mais aussi mythologiques ou antiques (dames à la toilette, nymphes, muses, grâces, etc.). Le portrait de Sabina Poppæa serait ainsi une sorte de palimpseste iconographique qui nous rappellerait l’importance du voile à la Renaissance, tant sur le plan esthétique que moral et intellectuel.
Les références à la figure de Poppæa dans la musique sont, comme pour la statuaire antique, très limitées, puisqu’elles se bornent au seul opéra de Monteverdi L’incoronazione di Poppea (1642). La femme y est calculatrice et ambitieuse, mais sait aussi se montrer séduisante et douce devant les hommes. À l’instar du recours au voile comme motif iconographique – qui signale une cloison et un double mouvement entre le montré et le caché –, Monteverdi va tenter de traduire cette duplicité et cette complexité par des procédés harmoniques.
Un voile qui montre pour mieux cacher
Après ce bref exposé des enjeux de cette journée d’étude, une question s’impose: avons-nous dévoilé Sabina Poppæa? Oui, et non… Il y a peu de réponses et d’affirmations catégoriques. Mais la journée a permis de formuler de nouvelles questions et des pistes à suivre pour des recherches futures. Elle a aussi mis en avant des axes de réflexion qui placent le tableau au cœur de problématiques nouvelles.
Nous avons scruté le tableau et le personnage qu’il représente, mais un mystère l’enveloppe encore et nous rappelle que, face aux œuvres d’art, les chercheurs n’auront pas toujours toutes les réponses. On effleure, on apprend par petites touches, mais on ne trouve pas toujours les certitudes que l’histoire de l’art aime tant. Comment se placer face à tout ça? L’une des dernières interventions d’une personne du public résume très bien cela: après toutes ces tentatives d’approcher l’œuvre, elle avoue, presque gênée, que le tableau la trouble, la touche et la fascine. Nous sommes là dans un territoire difficile à cerner, celui de l’expérience esthétique, sensorielle et émotive, du tableau. Et finalement, la remarque de cette personne, avec sa sensibilité, nous place devant un élément troublant de ce portrait: le regard du modèle, son geste, son léger sourire, son corps dévoilé… ce sont des éléments qui peuvent faire deviner une proximité entre le modèle et l’artiste que nous partageons le temps d’un regard. C’est peut-être cette proximité qui nous trouble, et qui nous défie sans cesse…